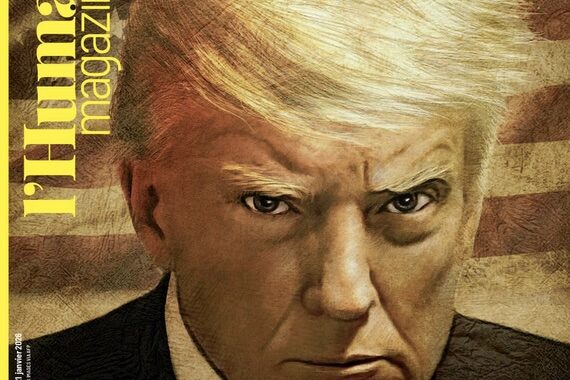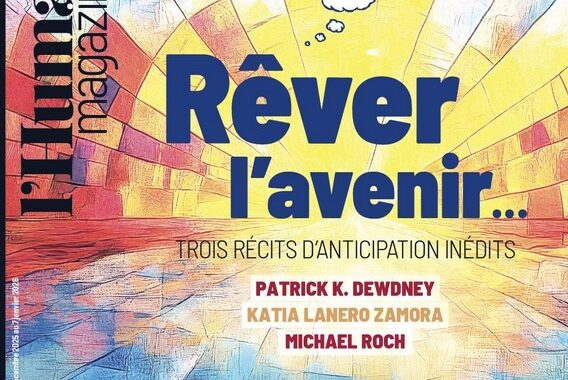Category Archives: Culture
Pierre Dharréville. « Nous croyons à la culture comme vecteur d’émancipation » (La Marseillaise)
Pierre Dharréville est responsable de la commission culture du PCF, qui a impulsé ces nouveaux états généraux de la culture(*).
La Marseillaise : Comment est née cette dynamique autour des nouveaux États généraux de la culture ?
Pierre Dharréville : Cette initiative, nous avons été un certain nombre à la vouloir et nous sommes un certain nombre à l’organiser, dans une vraie diversité de forces politiques, syndicales, sociales, culturelles. Au sein du PCF, nous avons produit des gestes qui visaient à ce qu’on prenne à la hauteur cette grande question de la bataille culturelle. Nous avons notamment lancé, en mars dernier, à la Bellevilloise, l’initiative « Vive la culture ! » puis, au dernier festival d’Avignon en juillet, l’appel pour de nouveaux états généraux de la culture, dont sont notamment signataires la CGT, la FSU, LFI, le PS, l’Après, les syndicats d’artistes Sinavi et Syndeac, ainsi qu’un bon millier de personnalités du monde de la culture. C’est très ouvert.
La Marseillaise : Ce mouvement sonne comme un appel à la résistance…
Pierre Dharréville : Il y a en effet un caractère de résistance inscrit dans cette démarche car nous voyons bien que la culture et les acteurs culturels sont attaqués, que les budgets de la culture diminuent à l’échelle nationale, que le budget des collectivités est lui-même soumis à des réductions drastiques qui mettent les collectivités dans des situations difficiles pour mener à bien leurs missions, notamment en matière de politique culturelle. Or les collectivités locales sont les principales financeuses de l’action culturelle dans notre pays. L’affaiblissement de ces politiques culturelles est d’autant plus problématique qu’il y a en face des forces, notamment les forces de la finance, qui se sont engagées dans de grandes logiques de concentration des outils de diffusion, des outils de production, des outils culturels et médiatiques. Avec un certain nombre d’acteurs qui ont des intentions politiques affirmées d’extrême droite et qui visent à reconfigurer l’espace public et politique.
La Marseillaise : Vers quelle conception de la culture risque-t-on de dériver sous la pression conjuguée de cet affairisme et des idées d’extrême droite ?
Pierre Dharréville : Jack Ralite disait, lorsqu’il a lancé les premiers états généraux de la culture en 1986, qu’« un peuple qui abandonne son imaginaire aux affairismes se condamne à des libertés précaires ». C’est toujours à l’ordre du jour. Et lorsque cet affairisme a des intentions politiques réactionnaires et trumpistes, pour dire les choses telles que nous les voyons à l’œuvre aujourd’hui, c’est d’autant plus dangereux. Ça renforce la nécessité d’avoir des politiques publiques, démocratiques, qui soient déterminées par des choix communs. La culture est un bien commun, elle doit être conçue comme cela. Or il y a plusieurs manières de la concevoir, c’est là qu’il y a une bataille aujourd’hui. Certains veulent nous enfermer dans des identités. Nous, nous croyons à la culture comme vecteur d’émancipation, de rencontre, d’épanouissement, d’ouverture, d’interrogation, comme porteuse de sens. C’est pour cela qu’il y a besoin de politiques publiques, autrement la culture devient un bien de consommation comme les autres. C’est la logique du rentable, de la productivité, de ce qui a commercialement fonctionné qui l’emporte. C’est le marché qui décide, avec les moyens qu’on y met. Une œuvre sur laquelle on a mis beaucoup de moyens de promotion et une œuvre qui n’en a pas reçu ne connaissent pas le même sort, c’est évident. Ça signifie aussi qu’on donne sa chance à un certain type d’art, de culture et de création et pas à d’autres. Est-ce que ce sont les forces de l’argent qui doivent décider de cela ? Je ne crois pas. La logique des blockbusters, des best-sellers et compagnie s’installe. Il y a une sorte d’uniformisation culturelle qui accompagne ce mouvement, car c’est ça qui crée de la rentabilité économique et permet, aussi, de formater utilement les esprits.
La Marseillaise : L’appel lancé en juillet dernier décrète « l’état d’urgence culturelle »…
Pierre Dharréville : Oui ce sont les mots par lesquels nous avons lancé ces nouveaux états généraux. La situation est particulièrement grave et nous inquiète chaque jour un peu plus. On peut citer, notamment, les offensives d’un monsieur comme Pierre-Édouard Stérin, qui cherche dans les milieux culturels à installer un nouvel empire avec des intentions, parfois cachées, pour formater un certain nombre d’espaces, d’outils, de moyens. Avec des labels de fête populaire ou en développant des outils de parcs d’attractions autour d’une Histoire bien souvent falsifiée et dévoyée. On en est donc à décréter cet état d’urgence culturelle, d’autant que l’affaiblissement conjoint des politiques publiques se vérifie, de budget en budget, avec des structures qui tirent la sonnette d’alarme.
La Marseillaise : L’exception culturelle française est-elle en train de se dissoudre ?
Pierre Dharréville : Cette bataille de l’exception culturelle a été menée à l’époque des états généraux de Jack Ralite, pour sortir la culture des accords commerciaux du Gatt. C’est cela l’exception culturelle : sortir la culture des logiques de marché, installer des politiques publiques qui soient capables de faire exister la culture indépendamment ou autrement que par les logiques marchandes. Cette exception culturelle est française parce que nous en avons été porteurs et qu’il y a eu, dans notre pays, une affirmation de ce point de vue là. Elle est en effet largement remise en question aujourd’hui, mais nous conservons des outils de politique publique et d’exception culturelle importants, comme dans le cinéma avec le CNC par exemple. Il y a également une vitalité et un tissu culturels dans notre pays qui continuent de formuler un certain nombre de propositions salvatrices. On peut donc aussi d’appuyer sur cette vivacité culturelle qui demeure malgré tout.
La Marseillaise : En quoi la culture est-elle le meilleur rempart aux idées d’extrême droite ?
Pierre Dharréville : De manière générale, la culture est un mouvement d’émancipation car au cœur de ce mouvement, il y a la rencontre, ainsi que les libertés d’expression et de création. Ces fondements font que la culture permet d’aller plus loin que soi, de s’interroger, de réfléchir à la société dans son mouvement, et de répondre à cette question : quelle humanité nous voulons être ? Finalement chaque geste culturel, chaque geste de création est une tentative de réponse à cette question, ou une tentative de la poser. Nous avons besoin de la culture pour nous retrouver, nous interroger, faire la fête, essayer d’imaginer, d’inventer l’avenir, de comprendre ce qui nous est arrivé ou tout simplement ressentir des émotions et les partager. C’est tout l’inverse d’un projet politique tel que le défend l’extrême droite et tel qu’il se déploie actuellement à l’échelle internationale, avec des logiques trumpistes à l’œuvre un peu partout, qui visent à installer une logique de la loi du plus fort, de la soumission.
La Marseillaise : L’extrême droite est également attirée par la censure…
Pierre Dharréville : Il y a, dans ce qui est à l’œuvre dans la société aujourd’hui, une forme de censure, effectivement, et d’autocensure parfois, qu’on cherche à imposer à certains acteurs sociaux et culturels à travers un certain nombre d’injonctions. On voit bien aussi de quelle manière sont utilisés certains médias pour essayer de faire pression, de reconfigurer l’espace du débat et la possibilité de dire. Donc oui, la censure fait partie des pratiques de l’extrême droite, l’atteinte à la liberté d’expression et de création. On observe aussi une sorte d’abaissement du débat public comme de notre conception d’être humain. Lorsque des commentateurs de la vie publique, qui en sont en réalité des acteurs, expliquent qu’ils disent tout haut ce que la majorité pense tout bas, on est dans l’ordre de la pulsion, de l’individualisme forcené. La culture peut être un antidote puissant face à tout ça.
La Marseillaise : Quel est l’enjeu, le sens de ces nouveaux états généraux ?
Pierre Dharréville : Nous voulons créer dans la société un mouvement pour la culture. Pas un mouvement qui rassemble uniquement des gens dont la culture est le métier, même s’ils en sont pleinement partie prenante. Nous voulons que cette question soit une grande question démocratique et citoyenne. C’est pour ça que ce mouvement a vocation à s’enraciner dans le local, avec des initiatives, je l’espère, un peu partout dans le pays, qui ont commencé. Et aussi avec une portée nationale : c’est un mouvement qui veut installer une dynamique incontournable pour peser dans le rapport de force, empêcher qu’on continue cette dégringolade des politiques publiques et imaginer les politiques publiques dont nous avons besoin aujourd’hui. On va donc s’intéresser à tous les champs de la culture, depuis le spectacle vivant et les arts plastiques jusqu’au livre en passant par les médias. Tout un tas d’acteurs sont engagés dans cette démarche et nous allons tenter de la construire ensemble.
Propos recueillis par Amélie Goursaud (La Marseillaise, le 26 janvier 2026)
(*) Déjà oubliée en 2020, la culture peine toujours à se faire entendre dans la campagne des municipales. C’est pourquoi le PCF organise ce lundi les États généraux de la culture à Nîmes. Le secteur fait face à une baisse historique de ses moyens financiers auquel s’ajoute le risque de voir l’extrême droite remporter des municipalités. Les initiatives et soutiens municipaux ont fait leurs preuves : de la grande diversité promue par l’Été marseillais, et les entrées gratuites aux musées à Martigues, jusqu’à Avignon qui accueille l’emblématique festival de théâtre en passant par Toulon et son festival de jazz pour tous. Autant d’initiatives, d’expérience et d’acteurs qui aujourd’hui potentiellement en danger.
Camps de la Retirada. Les dessins de Bartoli à La Jonquera (L’Indep)
Artiste prolifique, républicain espagnol engage, le Catalan Josep Bartoli, a témoigné de la guerre, de l’exil et des camps d’internement français dans une série de dessins aujourd’hui exposés en Catalogne, à La Jonquera.

Après avoir été exposées au Mémorial de Rivesaltes de 2021 à 2022, les œuvres de Josep Bartoli traversent cette année la frontière pour témoigner de l’exil à La Jonquera, au MUME, le Musée mémorial de l’exil de la petite commune catalane. Cette nouvelle exposition, baptisée « Dessiner, c’est combattre », s’annonce itinérante.
« Des armes fragiles mais redoutables »
Josep Bartoli (1910-1995) a dû quitter son pays en février 1939 devant l’avancée des troupes franquistes. Comme un demi-million de ses compatriotes, il fut interné dans les camps de la Retirada, au Barcarés, dans les Pyrénées-Orientales, et à Bram, dans l’Aude.

De ses séjours forcés, il a témoigné avec son talent de dessinateur, en croquant le quotidien particulièrement difficile des premiers réfugiés espagnols en France. Des dessins qui prennent à témoin ceux qui les regardent, et qui traversent les générations grâce au travail de son neveu, le photo-reporter Georges Bartoli.
Infatigable promoteur du travail de son oncle, il soulignait ce 17 janvier 2026, lors du vernissage de l’expo à La Jonquera : « Ce n’est pas la première fois que Josep revient en Catalogne mais il revient de plus en plus souvent ». Témoin lui aussi, derrière son objectif, des blessures de son temps, Georges Bartoli a tenu à faire le rapprochement entre deux époques : « Chaque scène dessinée ici peut se retrouver aujourd’hui, à Gaza, en Ukraine, en Iran ou parmi le sort des réfugiés que l’on rejette ».
La trentaine de dessins, présentés dans une scénographie de qualité au cœur du MUME, sont en effet autant de cris contre l’injustice faite aux plus faibles d’une époque. Celles et ceux de la Retirada ont vécu la brutalité de l’internement, après celle de la dictature qui s’installait de l’autre côté des Pyrénées.

Ces dessins, « des armes fragiles mais redoutables », souligne la directrice du Mémorial de Rivesaltes, Céline Sala-Pons, représentée à La Jonquera par Greg Tuban, responsable scientifique du Mémorial.
En plus des dessins, de nombreux documents éclairent sur Josep Bartoli et sa folle vie, de Barcelone à New-York ou Mexico.
Frédérique Michalak (L’Indépendant, le 23 janvier 2026)
Karl Marx, Notes sur James Mill
Pendant son exil parisien (1843-1845), Karl Marx rédige les fameux Cahiers de Paris, dont sont issus les Manuscrits de 1844 et ainsi que les Notes sur James Mill. Ces notes sont les plus développées et les plus complètes de tous les cahiers parisiens. Elles sont pour la première fois traduites et publiées intégralement en français.
Elles nous font pénétrer dans le laboratoire du jeune Marx, dans sa critique de l’économie politique et son travail de lecteur et de traducteur.
Le texte a été traduit par Herbert Holl, Alain Patrick Olivier et Maïwenn Roudaut dans le cadre du séminaire MARXMILL (université de Nantes, 2019-2020).
Ce livre des éditions sociales a bénéficié du soutien de la Fondation Gabriel Péri et du Centre de Recherche en Éducation de Nantes.
Commander
Leon Battista Alberti, figure oubliée de la Renaissance, inventeur de l’athéisme
Dans son ouvrage « L’Œil ailé, la naissance de l’athéisme »(*) (éditions Pont 9), le philosophe Jean-Michel Galano explore la figure oubliée de Leon Battista Alberti. Au cœur de la Première Renaissance italienne, ce précurseur est l’auteur du Momus, une satire corrosive qui démonte les « puissants » et met à nu la mécanique de la sacralisation. Entretien.
Qui est Léon Battista Alberti ?
Jean-Michel Galano : C’est un bâtard, le fils illégitime et non reconnu d’une grande famille florentine exilée à Gênes. Non reconnu, donc spolié de son héritage et obligé de ne compter que sur lui-même pour se faire reconnaître dans la société et pour, comme on le dit, se faire un nom. À telle enseigne d’ailleurs qu’il s’est donné un nouveau prénom, mettant « Leon » devant son prénom officiel « Battista ». Il s’est donné aussi ses propres armoiries. Au plan professionnel, sa grande singularité est d’avoir commencé comme juriste, « abbreviatore » c’est-à-dire rédacteur à la Curie romaine, et à ce titre spectateur privilégié, mais spectateur impuissant, d’une papauté en crise et même en décomposition. Et alors que ses goûts et son tempérament le portaient initialement vers la littérature (il avait organisé, le tout premier, un concours de poésie en « volgare », c’est-à-dire en italien populaire), il bifurque vers les sciences appliquées, notamment vers l’ingénierie, la cartographie et surtout l’architecture. Ce genre d’évolution menant de la littérature et de la fréquentation des milieux politiques à la pratique des arts appliqués est rarissime.
Il est vraiment l’homme de la Première Renaissance : cette période de crise et de rupture, qui est aussi celle de Jérôme Bosch et du Moyen Âge finissant, n’a pas la sérénité, la mesure et l’ampleur esthétique qui s’épanouiront lors de la Seconde Renaissance, avec les réalisations notamment dans les arts plastiques de Raphaël, Léonard de Vinci et tant d’autres. La Première Renaissance est un moment critique, celui où le fait de la dislocation d’un monde ancien s’impose aux yeux de tout témoin lucide, alors que les valeurs émergentes caractéristiques d’un monde nouveau peinent à s’affirmer.
Pourquoi avoir écrit sur lui aujourd’hui ?
Jean-Michel Galano : Notamment parce que nous sommes à beaucoup d’égards dans une situation comparable. On sent bien que notre civilisation est en crise, et même en péril. Sous le vocable de « nouveau monde », un « Jupiter autoproclamé » a cherché à nous vendre les recettes les plus éculées du libéralisme économique. Comme le disait Gramsci, les « monstres » ont surgi parmi nous, et les pires régressions sont non seulement possibles, mais déjà dans les journaux. Il était bon de montrer à certains que l’histoire bégaie.
Pour quelqu’un qui ne l’a jamais lu : qu’est-ce que le Momus (le texte que vous mettez au centre) raconte, et pourquoi vous le jugez si explosif ?
Dans la mythologie grecque, Momus est un dieu très mineur, qui correspond tout à fait au « grincheux » des contes pour enfants : c’est celui qui n’est jamais content, qui trouve tout le temps à redire, et qui par exemple suggère que Zeus aurait pu mieux faire, par exemple en dotant le corps humain d’une fenêtre permettant de voir ce que chacun a dans le cœur. Un bouffon parfois drôle et parfois exaspérant. Alberti fait de ce personnage tout autre chose : un ferment désintégrateur, une puissance non plus de négation mais de négativité, qui démolit impitoyablement les figures d’une harmonie factice, et notamment le paternalisme et le pharisaïsme des dieux, qu’il appelle significativement « superi », c’est-à-dire « les puissants », en rappelant et en retournant contre eux la violence prédatrice dont leur pouvoir est issu.
Votre sous-titre parle de « naissance de l’athéisme » : de quel athéisme parle-t-on exactement, et comment le repérez-vous au XVe siècle sans plaquer nos catégories d’aujourd’hui ?
Jean-Michel Galano : L’athéisme d’Alberti est de l’ordre du fait, et se manifeste d’abord comme une sorte d’inaptitude à imaginer quelque forme de transcendance que ce soit. C’est ce qui m’a frappé à ma première lecture du Momus. Les dieux et les hommes vivent dans la même temporalité, dans le même espace, partagent les mêmes passions. Il y a des dieux stupides. Il y a des dieux séniles. La seule différence entre les deux « races » est que les « superi » ont infligé aux hommes, à l’origine tout aussi divins qu’eux, la mortalité et les tourments qui vont avec. Ils vivent du produit du travail des hommes, qu’ils s’approprient par le biais de la sacralisation, et de leurs offrandes. Ils ne vivent qu’avec notre permission.
Alberti ne fait en aucune façon une théorie de l’athéisme. L’athéisme est chez lui instinctif. On est dans un matérialisme intégral. Évidemment, le problème de tout matérialisme est de rendre raison de l’immatériel : signifiés, rapports, catégories, temps, nécessité : Alberti n’esquive pas cette difficulté. Il y répond en faisant fonctionner les catégories de la cosmologie et surtout de la logique stoïciennes : le destin, figure chez lui de la nécessité, et les différents aspects de la théorie stoïcienne du signe.
Qu’est-ce que « L’œil ailé », qui donne son titre à votre livre ?
Jean-Michel Galano : Comme je l’ai dit, Alberti s’est donné à lui-même son patronyme et ses armoiries, lesquelles exhibent les valeurs dont il se réclame : curiosité, lucidité, vitesse, regard du technicien qui saisit à la fois l’ensemble et le détail. Valeurs et normes qui rompent avec celles en honneur dans le christianisme médiéval de modestie, de soumission et de prudence.
Dans votre lecture, Alberti invite à se détourner des « illusions religieuses et mythologiques » : qu’est-ce qu’il reproche au religieux, et qu’est-ce qu’il met à la place ?
Jean-Michel Galano : Au-delà des critiques strictement politiques qu’il fait de la papauté, et qui nourrissent sa féroce satire, Alberti produit une critique véhémente de la consécration et de la sacralisation – termes exactement synonymes. Il interprète la démarche qui consiste à rendre grâce aux dieux comme une intrusion violente des « superi » dans la vie des hommes. Les grands comme les petits plaisirs de la vie sont gâchés par la mauvaise conscience et projetés « au ciel ». De surcroît, la vie est trop courte pour faire davantage que commencer à la vivre.
Mais Alberti ne s’en tient pas à cette dénonciation. Il propose une double issue à cette situation aliénante.
– D’abord, cesser d’accorder notre créance à des dieux qui, à supposer même qu’ils existent, ne la méritent pas. Pas de confiance, donc pas de croyance ! La croyance doit se dépouiller de toute affectivité, et n’être considérée que comme un crédit ou encore une créance, accordée conditionnellement et révisable.
– Ensuite, il convient de travailler à mieux connaître les conditions matérielles de l’existence humaine, de façon à allonger la durée de la vie et d’en améliorer la qualité, à défaut de vaincre la mort. D’où l’importance conférée au cadre matériel de la vie des hommes, sur lequel il est possible d’agir : architecture, urbanisme, hygiène publique. D’où également l’importance de développer une connaissance objective de la vie et de la nature permettant de relier les passions, si dévastatrices quand on les subit, à une physiologie des humeurs, s’affranchissant ainsi des discours moralisateurs. Avec à la clé une recommandation aux « princes » : assurer la paix et laisser chercheurs et techniciens travailler à améliorer la vie humaine.
Au-delà, Alberti cherche à remplacer la dévotion par le rire, « rire décent », prétend-il : rire souvent féroce, mais qui relève aussi de l’ironie la plus subtile, comme en témoignent de nombreuses séquences antithétiques de la Bible, des Évangiles et de la Divine Comédie de Dante. Witz enfin, qui convertit, c’était bien leur tour, les stériles illusions religieuses en fécondes et suggestives images poétiques.
Qu’est-ce que votre Alberti dit de nos débats contemporains sur la sécularisation, la technique et l’émancipation ?
Jean-Michel Galano : Beaucoup de choses en fait, et le mécanisme d’aliénation par le biais de la sacralisation est à l’œuvre sous nos yeux perpétuellement et en temps réel : « figures », personnages « charismatiques », fantasmes d’harmonie sociale, paternalisme, acceptation des bouffons et des parasites, mais intolérance réelle à l’égard du sujet différent. Quand Witold Gombrowicz dénonce dans Ferdydurke ce qu’il appelle la « cuculisation », c’est-à-dire l’infantilisation organisée par le pouvoir en place non seulement des enfants et des jeunes, mais de toute la population de façon à imposer un ordre éternitaire et à couler tout le monde au même moule, il me semble qu’il retrouve l’inspiration d’Alberti dans le Momus. Mais je pense aussi que vous avez raison de faire le lien entre sécularisation, technique et émancipation ; Alberti a donné l’exemple d’une véritable culture technique, lui qui a inventé l’anémomètre et très probablement la camera obscura tout en s’occupant de poésie, de réflexions sur l’éducation et de cartographie. Or la notion de culture technologique est encore de nos jours l’objet de dénigrements et de refus. L’humanisme est encore trop souvent réduit aux « humanités ». Et il me semble illusoire d’imaginer une laïcité sans processus effectif de laïcisation, c’est-à-dire d’acquisition par chacun et chacune d’une autonomie de jugement et d’action, ce qui passe par l’appropriation effective du plus grand nombre possible de savoir-faire et de savoir-être. Alberti, lui-même excellent cavalier et très habile de ses mains, était le contemporain des premiers théoriciens de l’éducation physique et de l’initiation aux travaux manuels. Toutes choses dont nos institutions actuelles se désintéressent de plus en plus, ce qui porte en germe un recul de la citoyenneté. Oui, nous avons encore à tirer profit d’analyses produites déjà au XVe siècle, et ce n’est pas pour nous un titre de gloire.
Propos recueillis par Maxime Cochard (revuecommune.fr)
(*) Jean-Michel Galano, « L’Œil ailé, la naissance de l’athéisme », éditions Pont 9, 2026, 25,90 €.