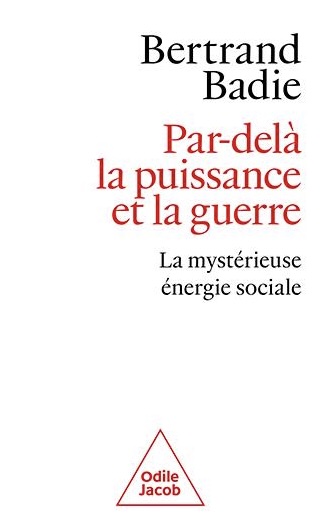Bertrand Badie est professeur émérite à Science Po et spécialistes des relations internationales.
La Marseillaise : La mort de l’ayatollah Khamenei marque un tournant ?
Bertrand Badie : Cet homme était au pouvoir depuis 1989, il incarnait la ligne dure, conservatrice et ultra-religieuse de la République islamique. Il détenait l’essentiel du pouvoir et le processus décisionnel en matière militaire, diplomatique, d’ordre intérieur. Le président de la République ne pouvait être élu sans son aval. C’est plus une rupture qu’un tournant. Le modèle est incontestablement cassé mais personne ne sait encore de manière sérieuse ce qui va en sortir.
La Marseillaise : Ce n’est pas pour autant la fin du régime ?
Bertrand Badie : C’est absolument impossible de dire ça. Si l’homme était la clé de voûte de l’édifice, le régime se caractérise par un socle extrêmement important bâti au fil des décennies, composé des pasdarans, des bassidjis, de la police et de l’armée. Ce nombre très important de personnes dispose de réseaux et se sont appropriés les biens économiques du pays. Un régime ne prend pas fin tant qu’un autre ne vient pas le remplacer et on est très loin de la mise en place d’une alternance.
La Marseillaise : Reza Pahlavi incarne-t-il l’opposition ?
Bertrand Badie : Il y a une opération médiatique autour de la personnalité du fils de l’ancien chah renforcée par le fait que nous avons affaire à un régime ultra-autoritaire et répressif qui n’a pas d’opposition organisée. Dès lors, le nom de Reza Pahlavi est le seul qui puisse apparaître spontanément comme contre-marque au régime islamique. Une façon de crier son hostilité au régime, c’est de se référer à la seule force visible ou incarnée qui lui fasse opposition. Le régime Pahlavi était comparable à l’actuel : épaisseur répressive, corruption et personnalisation du pouvoir. Il ne faut pas exagérer l’idée de désertification des oppositions dans la mesure où dans les prisons iraniennes figurent des personnalités non négligeables mais réduites au silence.
La Marseillaise : Les « négociations » entre Washington et Téhéran n’étaient qu’un leurre ?
Bertrand Badie : Il apparaît, pour le moment, que ces négociations n’étaient qu’un prétexte permettant de dissimuler ou d’ouvrir un temps de préparation de l’action militaire. On parle beaucoup de « régime change ». Je parlerais de « régime destruction », l’objectif n’est pas de démocratiser l’Iran ou de rendre le pouvoir au peuple mais de détruire un régime et on ne voit pas de plan visant à aller au-delà. En cela, la distinction est forte par rapport à ce qu’était la politique de George W. Bush en Irak en 2003 où il voulait véritablement mettre en place un régime « démocratique » affidé aux États-Unis. Là, on s’arrête à la destruction, derrière laquelle on retrouve non plus la ligne américaine mais israélienne qui est de considérer que la meilleure façon d’assurer sa sécurité et son hégémonie régionale, c’est de détruire toutes les résistances qu’il y a autour. Cela s’est fait à Gaza, en Syrie, en Irak, partiellement au Yémen et c’est en cours en Cisjordanie ainsi qu’au Sud-Liban. Le Moyen-Orient se transforme peu à peu en un champ de ruines qui soulève autant de questions et d’incertitudes qu’il ne répond aux attentes des populations. Si, véritablement, on assiste à un démantèlement de tous les systèmes politiques environnants, on risque à terme d’avoir affaire à une jungle où chaque individu se repliera sur sa petite communauté d’appartenance. Cela créera une situation évoquant davantage la Libye actuelle qu’un système véritablement reconstruit. Trump va faire valoir qu’il a marqué un point en neutralisant celui qu’il appelle « le pire des dictateurs que le monde n’ait jamais connu ». Il va être très vite pris à son propre piège car ses électeurs ne souhaitaient pas de troupes sur le sol et on a appris que trois soldats américains ont été tués.
La Marseillaise : Une guerre régionale est en cours ?
Bertrand Badie : C’est difficile de dire autre chose. Il y a des indicateurs qui ne trompent pas : le fait que l’espace aérien de la Turquie jusqu’à la mer d’Oman soit fermé de même que le détroit d’Ormuz comme le canal de Suez. Tout cela ressemble à une zone de guerre avec le risque réel pour les populations couvrant cette superficie du Moyen-Orient d’être exposées à n’importe quel moment à des frappes. On est très clairement dans une logique de guerre.
La Marseillaise : Face à cela, que penser des réactions européennes ?
Bertrand Badie : La pauvreté de la réaction européenne, qui encore une fois ne parvient pas à se situer et se faire le défenseur du droit international, dont elle prétend être le dépositaire, aux rares exceptions que constituent la Norvège et l’Espagne. Tout ça exprime une sorte d’embarras qui devient structurel dès que les pays européens ont à se situer par rapport à des conflits internationaux.
Entretien réalisé par Laureen Piddiu (La Marseillaise, le 2 mars 2026)